


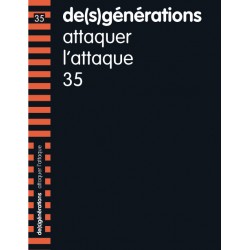




Rédacteurs : Gaëlle Vicherd & Philippe Roux
Sommaire
Iconographie : Marine Lanier
Caractéristiques techniques
Date de publication : décembre 2021
Format : 14,8 x 21 cm - 128 pages
ISBN : 978-2-9570700-4-6
ISSN : 1778-0845
Édito
« Marx a dit que les révolutions sont la locomotive de l’histoire mondiale. Peut-être que les choses se présentent autrement. Il se peut que les révolutions soient l’acte par lequel l’humanité qui voyage dans le train tire les freins d’urgence ». Walter Benjamin dans ses thèses sur le concept d’histoire, nous avertissait déjà en 1940 que le progrès illimité, érigé en norme historique, nous conduirait à la catastrophe. À présent, nous sommes tous les passagers du train suicide de la civilisation capitaliste moderne. Notre action doit donc viser à arrêter le train avant qu’il ne soit trop tard. Rien que cela.
Le temps du monde fini
En 1931, Paul Valéry annonçait dans son livre Regards sur le monde actuel que « le temps du monde fini commence ». Lisons notre situation contemporaine comme le moment où la croissance illimitée de l’économie bute sur le réel. Nous touchons concrètement les limites d’un modèle qui ne peut envisager sa propre fin. Le capitalisme, qu’il prenne un aspect théologique, autoritaire ou libéral, extrait de la matière et la restitue sous forme de déchets et pollutions diverses. Le monde fini ne peut absorber infiniment les polluants sans voir les conditions mêmes de la vie radicalement modifiées, voire supprimées. Un sol cultivé, au-delà d’une certaine quantité d’intrants chimiques administrée, meurt et devient improductif. Un paysage recouvert de trop de revêtements artificiels n’absorbe plus l’eau et est inondé. Le carbone, consumé et rejeté dans l’atmosphère réchauffe irrémédiablement le climat. Un être humain, soumis à une logique qui va à l’encontre du sens commun, tombe en dépression. Une forêt en manque d’eau permanente finit par sécher et brûler, etc. Repousser les limites toujours plus loin demande beaucoup d’énergie et ne règle en rien le problème. C’est la grosse fatigue, l’épuisement général.
En psychologie, la psychose se distingue essentiellement de la névrose par le fait que le sujet psychotique n’a pas conscience de ses troubles et qu’il perd contact avec la réalité. Mais dans le cas du capitalisme, que l’on qualifiera ici de « psychotique », on note un paradoxe et non des moindres : les militants du capital ont tout à fait conscience de leurs troubles mais, pour eux, être « dément » n’est pas un problème : ils avancent dans la société folle qu’ils génèrent, sachant très bien qu’ils mettent en œuvre les conditions de notre destruction. Ils savent qu’ils ont « décollé » du monde réel, comme des fusées cherchant à quitter la terre. Mais sortir de cette démence reviendrait à les faire disparaître. Donc ils continuent dans le délire : un capitalisme décroissant ? Pas possible. Un éco-capitalisme non extractiviste ? Pas possible. Un capitalisme ultra-technologique, inventeur d’une technologie messianique qui nettoierait nos océans, protégerait la planète de la surchauffe, dépolluerait les sols ou polliniserait les fleurs ? Pas possible. Et pourtant, nous entendons à longueur d’antenne nos « responsables » politiques être plus inquiets du ralentissement de la croissance que du réchauffement climatique. Allons gaiement, enfants de la patrie, vers la catastrophe. Leur démence est hors-sol. Horla, comme le personnage de la nouvelle de Maupassant, schizophrène qui dénie le réel. Le Horla de Microsoft, de Bayer-Monsanto et de tous leurs camarades de classe, n’est, lui, ni inquiet, ni angoissé, ni paranoïaque. Lui, ment. C’est une schizophrénie « enjouée » qui nie l’angoisse du réel. L’inquiétude générale est même un moyen pour lui de faire de l’argent. Ce capitalisme nouveau a des solutions, des solutions « en anglais » : la Green Tech. L’une des initiatives du ministère de l’Économie, pour laquelle l’argent public coule à flot, s’appelle d’ailleurs French Tech. Peut-être qu’avec Jacques Tati, on pourrait imaginer une visite des startups innovantes de la « Green » French Tech… Difficile d’en rire. Et après tout, les considérer comme « malades », n’est-ce pas encore trop euphémisant ? Psychologisant ? Et s’ils étaient tout simplement des criminels ?
La crise qu’est la nôtre n’est pas une crise : c’est une catastrophe irréversible. Pas de retour à la normale. Et cette catastrophe n’a rien d’un accident, elle est structurelle. Monde Horla, finance offshore, agriculture hors-sol, imaginaire déconnecté, acculturation normalisée, métavers stupéfiant. Opium du présent et de l’à-venir… Alors, que faire ? le fameux « que faire ? »…
Attaquer l’attaque, nouveaux phrasés, nouvelles figures
Nous ne pouvons plus nous contenter de répéter benoîtement dans des cortèges bien rangés « une seule solution : ré-vo-lu-tion ». Et il n’y a rien à attendre des gouvernements libéraux, de leur COP, de leur système. Cela fait plus de 50 ans qu’ils prétendent avoir compris la menace écologique et qu’en réponse à celle-ci, ils n’ont presque rien fait, ils multiplient les politiques d’austérité, de privatisation, de dérégulation, d’aide à la maximisation des profits des multinationales, d’aide à l’agro-business. En 50 ans, ils ont continué à ruiner les écosystèmes et la biodiversité. Cette logique mortifère ne pourra reculer que face à un rapport de forces conséquent.
Devant l’inertie générale, il nous paraît important de citer à nouveau Bernard Aspe : « les lois de l’économie ne sont pas le fruit d’une nécessité historique, mais un programme porté par des militants, susceptible en tant que tel d’être intégralement interrompu ». L’économie capitaliste est une politique, avec en son cœur « la mise au travail généralisée des êtres de nature ». C’est à cet endroit qu’il nous faut repenser les impasses de notre culture militante traditionnelle, dont les luttes se sont majoritairement concentrées sur le rapport travail humain / capital. Car il s’agit bien de prendre conscience que, loin de s’être limitée aux seuls humains, la mise au travail concerne depuis le début, les sols, les sous-sols, les océans, les plantes, les animaux, les cours d’eau, les forêts, le vent, le feu, etc.
« Attaquer l’attaque », c’est une formule de Mario Tronti dans son livre Ouvriers et Capital. « La stratégie, disait Tronti, c’est de refuser de participer au développement capitaliste. Mais plus encore, c’est attaquer ce développement en tant que tel (par la grève, le turn-over, l’absentéisme, le sabotage) ». Inspirons-nous donc de cette stratégie du refus du travail pour le capital en l’étendant à l’ensemble des activités, humaines et non humaines. C’est à dire qu’il nous faut non seulement refuser en tant qu’humains, de contribuer à la valorisation du capital ; démissionner, déserter, gréver, chômer le travail toxique, mais aussi être acteur du refus de la mise au travail d’êtres non humains ; bloquer les projets extractivistes, protéger forêts et bocages de la destruction, empêcher les bétonisations en tous genres, saboter les infrastructures nuisibles, comme le font avec un désir indestructible de nombreux collectifs partout dans le monde. Les répressions policières et judiciaires, ainsi que les stratégies d’épuisement, font que le prix à payer pour ces luttes peut être très élevé. Le rapport de force est souvent difficile à tenir, c’est pourquoi il est important de participer à ces combats et de les soutenir, mais aussi d’élargir notre vision des forces en présence.
Il y a des manifestations d’existences non humaines qu’il nous faut considérer comme forces de résistance au capital. Incendies, inondations, virus ou espèces invasives sont « des vivants ou des éléments [qui] résistent par eux-mêmes à cette mise au travail ». Léna Balaud nous invite à travailler ces résistances en créant des alliances qui nous permettent « de porter un refus politique organisé de ce qui nous mutile – un « nous » pas seulement composé d’humains ». Ce sont ces « résistances objectives qui nous mènent à une transformation subjective de nos regards de militants, vers une sensibilité plus écocentrée des conflits politiques ». Certains appelleront ces associations les soulèvements de la terre. Des « herbes résistantes aux herbicides, aux chauves-souris fuyant la déforestation […] des champignons occupant les réservoirs pour digérer les réserves de kérosène, ces résistances non humaines opposent de sérieux obstacles aux projets capitalistes ». La bonne nouvelle est qu’un capitaliste n’investira que dans un projet qui lui rapportera de l’argent. Plus les soulèvements de la terre seront nombreux, moins les investissements capitalistes seront rentables. Les plus grandes compagnies d’assurance disent elles-mêmes « un monde à +4C° n’est pas assurable ». La sphère d’appropriation du capitalisme se contracte. On peut l’envisager comme une tragédie car les pénuries vont créer des tensions insoutenables et provoquer des défaillances généralisées mais on peut aussi le voir comme l’opportunité historique de se poser enfin collectivement la question des besoins réels et de « l’administration de notre maison », soit le sens premier du mot « économie ».
Pour tous ceux qui luttent malgré tout, le temps du monde fini n’est pas le temps de la fin du monde. Chaque présent ouvre sur une multiplicité d’avenirs possibles. L’autre bonne nouvelle, c’est que ces à-venirs possibles, ces vies vivables, perdurent, s’expérimentent, se cherchent, se réinventent, déjà aujourd’hui en une multitude de lieux. Ce qui est visible (visibilisé) n’est pas la totalité de l’existant. Il y a de l’invisible et de l’invisibilisé qui travaille. Il y a des zones dans lesquelles des zonards creusent comme des taupes, cherchant, sans être vus, à ébranler l’édifice en surface. Il y a toutes ces expériences qui existent concrètement dans les ZAD, squats, collectifs, syndicats, communes, quartiers, jusqu’à la plus petite échelle. Toutes les tentatives de construction d’alternatives sont vitales. Mais, pour voir le temps venir, « être contre », ou « sortir de » ne suffira pas : n’être que dans la dissidence, la soustraction, le retrait, n’ouvre plus l’horizon. Pour formuler une proposition positive, il faut bien nommer ce monde – non capitaliste – que nous désirons : éco-communiste, ou éco-socialiste. Dire cela aujourd’hui, c’est articuler d’autres phrasés que ceux déjà pratiqués au sein du capitalisme et du socialisme dit « réel ». Par exemple : plancton/homme/canopée/oxygène. Articuler ces phrasés, c’est comprendre les points de conjugaison des polyphonies du monde et entendre le commun comme un passage, un entre-deux qui nous traverse et nous transforme sans homologuer. La vie d’un être humain n’est pas égale à celle d’un plancton ou d’un protozoaire, pourtant elle ne peut exister sans eux. Un milliardaire aussi doit sa vie aux syrphes, aux oribates ou collemboles. Pas moins qu’un ouvrier bangladais ou qu’un berger marocain. Ce communisme du vivant, auquel nous appellent Paul Guillibert et bien d’autres, est celui d’une nouvelle cosmologie politique, qui rebat les cartes d’un marxisme anthropocentré.
Pour figurer ce nouvel en-commun, il y a une infinité de phrasés à pourvoir d’une visibilité. Les arts sont à cet égard de précieux alliés, puisqu’ils donnent à voir, lire ou entendre, des phrasés que nous avions sous les yeux sans les voir ou à en imaginer de nouveaux. Si les œuvres d’arts sont des phares qui nous invitent à cheminer autrement, elles ne peuvent se substituer à des pratiques politiques plus directes. Les combats que nous avons à mener sont rudes et violents. Formuler ce nouvel en-commun ne se fera pas dans l’innocence d’un communisme éthéré, qui diluerait la place de l’homme au sein du vivant. « Nous [humains] sommes des vivants très spécifiques qui avons un rapport réflexif à la nature d’un niveau sans équivalent ». C’est à cet égard que nous avons une responsabilité qui exige de prendre en charge les questions macro-sociales puisque c’est à cette échelle que nos ennemis organisent le monde chaque année depuis Davos ou quelque autre salon confortable.
Il nous manque aujourd’hui un manifeste, « une proposition communiste qui donnerait à une mobilisation générale l’appui de figures et de réalisations concrètes », comme l’ont fait Marx et Engels en 1848. Sortir du capitalisme ne veut pas dire ne plus produire ou ne plus travailler, ni faire disparaître la violence et la domination. Les questions de la production, des moyens de production, de la division du travail restent décisives, mais nous devons imaginer les institutions qui permettront de les sortir de la logique mortifère du marché. Il y a une production non productiviste, un travail non capitaliste, une valeur autre que marchande. C’est une véritable révolution culturelle et éducative qu’il nous faut imaginer et réaliser. Nous pensons avec Michael Löwy, que ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons avoir un contrôle public sur les moyens de production : « Le cœur de l’écosocialisme est le concept de planification écologique démocratique, dans lequel la population elle-même – et non le « marché », ou les banquiers et industriels, ou un Politburo bureaucratique –, prend les principales décisions concernant l’économie […] on ne peut imaginer une telle société nouvelle sans que la population n’atteigne, par la lutte, l’auto-éducation et l’expérience sociale, un haut niveau de conscience socialiste et écologique ». Ce numéro y contribue modestement, mais opiniâtrement.
Gaëlle Vicherd et Philippe Roux
Bernard Aspe, Léna Balaud, Jérôme Baschet, Paul Guillibert, Marine Lanier, Michael Löwy, Pierre Madelin, Andreas Malm, Jean-Claude Pinson , Fabienne Raphoz
